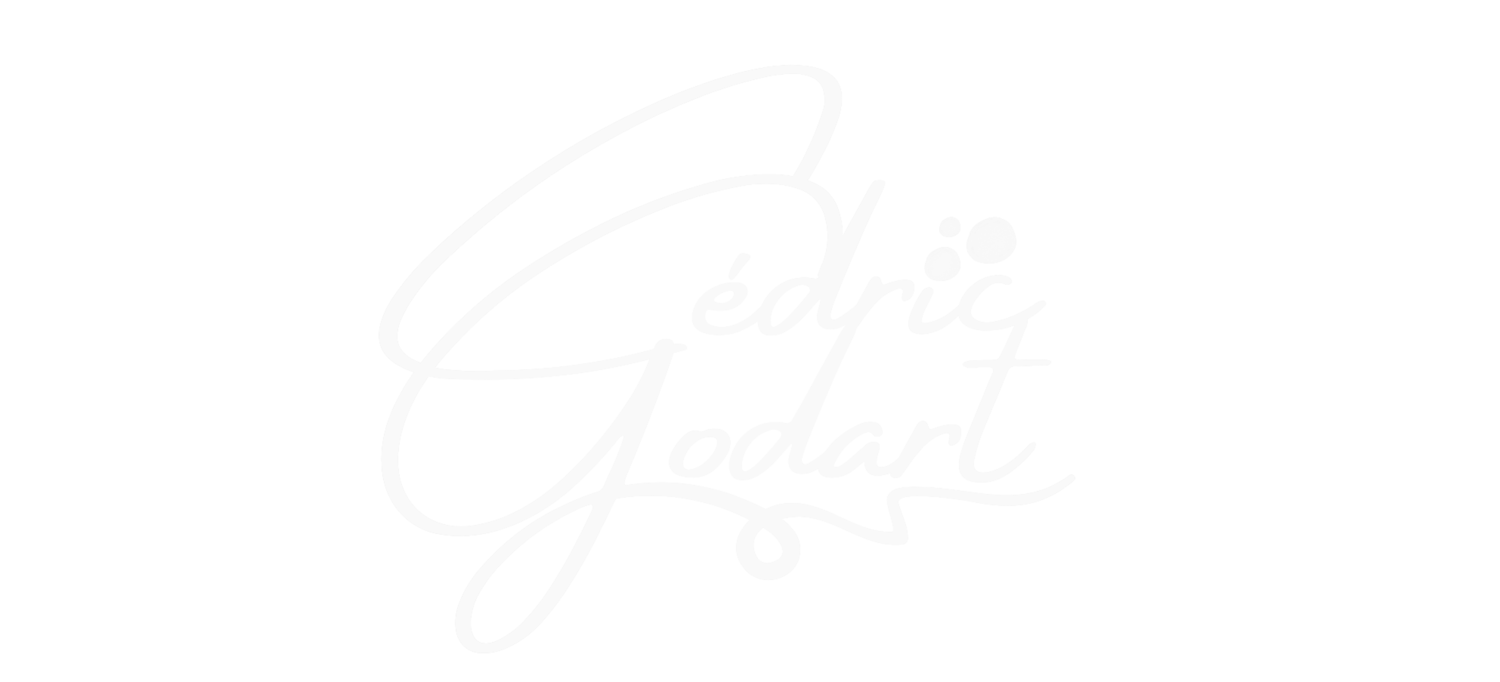Qu’est-ce que l’impatriation ?
On parle d’impatriation pour évoquer le retour de l’expatrié dans son pays d’origine. Je décrirais l’impatriation comme une forme de rupture amoureuse, qui laisse des traces, profondes, durables. Qu’il convient d’exprimer pour passer autre chose. Qui a une fin, heureuse.
Tire-t-on un trait sur une aventure d’expatriation au bout du monde comme on renonce à un caprice ? Certainement pas.
Que ressent-on après une impatriation ?
Dans mon cas, une blessure qui a mis plusieurs mois pour ne plus me faire souffrir. Qui parfois me réveille la nuit, mais de moins en moins. Il y a quelques jours, j’écrivais en cercle privé ceci, qui est une suite d’impressions cohérentes, mais livrées en ordre dispersé, de ce qu’il reste de San Francisco en moi :
« Je retombe sur cette série d’images. Elle ont deux ans. Autour de Russian Gulch State Park. Les jours étaient déjà comptés, mais je n’en savais pas grand-chose. J’ai garé la voiture allemande, bleue, ma belle voiture, sur le bord de la route, près d’un Inn perdu, qui devait ressembler au Bates Motel. J’ai pris trop de photos cet après-midi-là, comme pour m’étouffer de souvenirs. Je me suis probablement demandé s’il était possible d’arrêter le temps. Hélas non. C’était avant le déménagement à Goleta. C’était avant la déroute. C’était avant l’orage. C’était avant le retour. La rupture. La fin de la rupture. La renaissance. C’était loin d’ici. Sur une autre galaxie de la même planète.
Dans un autre chapitre de l’univers. Le soir, j’ai traversé le Golden Gate Bridge, machinalement, comme si je l’avais toujours fait. Comme si c’était normal. J’ai toujours erré dans le réel comme on sautille sur du coton. C’est une tactique pour que le réel fasse moins mal. Il faut se préserver. Revoir ces photos me donne l’envie d’y retourner, quelques jours, pour écrire, raconter, me taire, prendre des photos, pour rouler, tourner au rouge, parler cette langue qui est un peu devenue la mienne aussi et terminer la journée à Healdsburg. Une glace au miel à la main, dans le petit parc.
Puis revenir. Puis y retourner encore. Comme on voudrait retourner dans un rêve qui vient de s’achever sans dénouement possible, autre qu’imaginaire. Ou dans une histoire d’amour qui n’a pas eu la fin escomptée. Tu me manques, ma jolie Californie du Nord. »
Comment vit-on une impatriation ?
On traverse un processus d’impatriation comme un nouvel apprentissage, finalement aussi inattendu que l’expatriation elle-même.
Les magasins. Les transports en commun. La tonalité du téléphone. L’heure du journal télévisé. Le code de la route. Les conversations entre les proches. Les centres d’intérêt. Tout va de nouveau changer. On doit se réinventer dans un nouveau décor.
Une stabilité se réinstalle, très vite, une fois les démarches (compliquées, on n’a pas idée!) administratives franchies : inscription dans une commune, cotisations sociales, récupération de son numéro d’entreprise, stage d’attente pour obtenir le remboursement des soins de santé.
Les amis n’ont pas changé. Ou presque pas. Le cercle s’est restreint. C’est banal. Rien n’est vraiment organisé, l’expatrié est supposé partir, mais pas revenir. Et pourtant. J’avoue avoir croisé peu de rieurs.
Pourquoi suis-je rentré en Europe ?
Il m’a souvent été demandé pourquoi nous n’avions pas résisté plus longtemps que la fin de l’été 2016 à cette expatriation américaine.
Résumons très fort sans nommer : nous avons accepté l’offre commerciale d’une consultante en immigration à Santa Barbara, laquelle nous a mis en relation avec un couple de Français exploitant une pâtisserie à Montecito. Ces derniers nous ont (nous le savons à présent, puisque nous avons eu accès à un e-mail où ils déclaraient “avoir joué, avoir perdu”) vendu – en toute connaissance de cause – une entreprise de tourisme qui – les termes de la vente étaient clairs – pouvait être relancée en quelques semaines. En vérité, il s’agissait d’une coquille vide.
Le visa… et après ?
Visa E2 obtenu aisément, nous élaborons un site web, une stratégies des partenariats, nous prévoyons une embauche. Ensuite ? L’enfer administratif et la désillusion : un véhicule déclassé, une clientèle inexistante, des licences d’exploitation impossibles à obtenir… Bref, des mois d’errance et de pertes financières en vue.
En juillet 2016, l’évidence : il faut rentrer, c’est une question de survie. Nous avons tenté plusieurs recours, dont une médiation. Sans succès (les avocats et médiateurs américains ne s’encombrent pas de “petites affaires”).
Plaie d’argent n’est pas mortelle certes, mais tout de même : peu ou prou 70 mille euros de pertes. Et les dégâts psychologiques, presque physiques.
Et puis, l’impatriation devient un souvenir
Je pourrais glisser et déposer cette phrase, une fois de plus : « J’ai toujours erré dans le réel comme on sautille sur du coton. » Comme dans un rêve, un dessin animé, dans un tunnel où on crie pour entendre l’écho de sa voix, l’unique preuve qu’on est en vie. In fine, j’ai pu retrouver une vie normale, équilibrée je le pense, dans un autre couloir de la planète, qui est chez moi et que je n’ai jamais autant ressenti comme mes racines profondes.
Il m’arrive de demander si l’idéal ne serait pas de recommencer, de partir de nouveau en Amérique du Nord pour une nouvelle expatriation, mais jamais longtemps. J’élabore des projets d’écriture liés à la Californie, qui entraîneront des voyages, que j’envisage depuis 2018 sans jamais les avoir concrétisés.
Ces quatre années m’auront appris que j’avais une place dans mon pays d’origine, la Belgique.
Mon conseil : tourner la page
Voilà, j’avais envie de mettre des mots sur mon expérience. Des images et des explications, des faits et des dates, des impressions et des interprétations. Il en a fallu du temps et le texte a, au fil du temps, été réduit à sa plus simple expressions.
Il aura fallu attendre un jour de convalescence, au fond du canapé, un ordinateur portable sur les genoux, pour mettre des idées en phrases, des images au clair obscur.
Il m’est resté de l’Amérique un refrain de musique country : « Always be humble and kind. » Elle correspond exactement à l’image que je me fais de l’idéal. Cette phrase qu’on dit aux petits garçons en espérant qu’ils deviennent des hommes. On jugera plus tard. En attendant, on écrit le chapitre suivant.
L’heure est venue de tourner la page. Il est temps. Témoigner m’a semblé essentiel.
Depuis, j’ai appris à relativiser. Et à méditer.
Ce texte publié en février 2017 a été modifié en janvier 2019 puis en février 2020.