
« Comment c’est la vie, en Californie ? »
Je devrais avoir, je crois, des anecdotes à remplir des cahiers et des conversations. J’en ai quelques-unes, c’est vrai. C’est ce que l’on attend de vous quand vous vivez à 8 900 km de là où vous avez grandi, à San Francisco.
Expatriation et instinct de survie
Je me souviens de l’aéroport, de ce jour de 2013, à Bruxelles. Du suivant à Francfort. Je me suis demandé si j’avais bien fait. Si nous avions vraiment décidé. Il ne restait plus rien ou pas grand-chose de notre vie. Tout avait été vendu, à prix cassé, dans des brocantes (on n’imagine pas le poids émotionnel de cette phrase!). Il reste des caisses de documents, mais au fond trois fois rien.
La première année, le doute. Cette question constante qui consiste à se demander pourquoi on est là, pour qui on est là, ce qu’on cherche ou ce qu’on perd. La tentation de rentrer est partout, à tous les coins de rue.
La seconde année, l’éloignement du doute. On a connu les saisons déjà, rencontré quelques personnes, créé un univers qui n’est plus celui d’avant, qui n’est pas encore celui de demain. La tentation de rentrer est plus vague, elle ne surgit qu’à des dates précises.
On me demande si « je suis heureux».
Je regarde les autres expatriés pour me situer. Ceux qui sont souvent « sortis de leur zone de confort », dans le sens le plus noble du terme. J’en admire plusieurs. D’autres m’épuisent (cette phrase, l’air de rien, est complexe à écrire, car elle indique qu’on assume des sentiments comme le mépris ou l’indifférence vis-à-vis d’êtres humains dont nous ne savons à peu près rien des combats et des parcours !).
Il y a ceux qui ont eu le courage des oiseaux, migrateurs, qui ont suivi une étoile ou un but, qui sont persuadés d’avoir un destin. Peu importe s’ils ont réussi. L’Amérique est une formidable école pour expérimenter l’instinct de survie.
Il y a ceux qui ont été appelés – ou ont tout fait pour l’être ! – par l’une ou l’autre entreprise du “web”. Qu’auraient-ils gagné en Belgique ? 3 000 euros et une voiture de société ? Ils participent à ce qu’on appelle ici la « gentrification » de la ville de San Francisco, c’est-à-dire l’installation progressive d’une nouvelle bourgeoisie qui fait flamber l’immobilier. Son pouvoir d’achat est phénoménal. Elle transforme la ville. La rend plus « présentable ». Ces dernières années, une certaine jeunesse a investi les anciens quartiers hippies : fibre optique, restaurants végétariens, la nudité est désormais interdite. Jamais l’écart entre les salaires n’a été aussi infernal qu’ici. Il est plus palpable qu’en Belgique.
Je ne me représente pas encore très bien dans ce tableau que je décris. Peut-être n’ai-je pas trouvé de domicile fixe ? Probablement ma place est-elle ailleurs, pas loin, plus loin ? J’ai transporté, inconscient qu’il faut être, mes activités de free-lance au petit bonheur la chance. Avec la chute de l’euro, j’ai certains jours été gagné par une angoissante crainte du lendemain. Être « self-employed » ici, on n’imagine pas ! Des regrets ? Certainement pas. La réalité, tout simplement.
Ma vie est à peu près la même qu’avant
Sauf que je me suis adapté au décor – et que ce décor a un prix. Vous dormez quand je travaille. Je dors quand vous vous prenez votre première pause ; il m’arrive de manger plus tôt qu’avant ; je me suis créé une routine, qui inclut une heure de sport par jour. Je ne suis ni heureux ni malheureux, je suis juste un point déplacé sur la mappemonde. Mes vêtements ont changé. Mes habitudes alimentaires aussi.
J’en viens souvent à me demander ce que je fais ici et j’élabore des projets – multiples – de déménagement « partout ailleurs, mais pas dans le brouillard ». Fasciné toujours plus par la diversité des décors de cet État que j’ai rêvé un jour sur la carte du monde et qui m’a accueilli sans vraiment broncher. Ensuite, Sonoma, Napa, Santa Barbara, Santa Cruz, Monterey, Calistoga, San Diego.
Certains jours, certaines (personnes ou) choses me manquent. La simplicité des choses, des personnes, des mots, des sentiments. Le droit au silence et à l’introspection (suspect ici).
San Francisco : décor et illusions
Accent grave, venons-y ! Vivre à San Francisco, en plein cœur de la ville ; croiser de pauvres gars qui dorment dans la rue, des psychotiques qui promènent des poupées… Je suis venu chercher l’illusion que tout serait plus parfait que dans ma vie d’avant et qu’il suffirait de déménager pour effacer l’ardoise. Comme j’ai été naïf !
On me demande régulièrement si je compte revenir. J’avoue avoir donné mille et une réponses évasives ou définitives, sans avoir à ce stade trouvé ce qu’il convient de conclure à ce qui relève d’une… circonstance. Comme mon départ.
Il faudra prendre une décision, demain, l’an prochain. Je n’ai jamais été aussi perdu et quelque part ravi de cette déperdition. Elle m’a permis de me remettre à la photo, à l’écrit, de beaucoup lire, de beaucoup écouter, de comparer deux mondes si différents. Et puis, presque par hasard, je me suis lancé dans le photo montage, comme une manière de recoller les morceaux d’une réalité éclatée. Bref, j'ai grandi. Je me suis relevé, avec une certaine sérénité. Ne pas chercher à savoir me permet d’avancer, à pas feutrés. En répondant oui et non avec la même conviction d’un jour à l’autre. D’être tout et son contraire. Puisque ici tout est son contraire. C’est tout simplement le quotidien.
Comme j’ai désiré cette ville, comme elle me donne encore le vertige, comme elle ne m’a jamais semblé aussi irréelle aujourd’hui. Et comme la tentation n’a jamais été aussi forte de gagner des terres moins occupées. C’est grand, l’Amérique, j’ai trouvé des millions d’endroits où me perdre, me trouver, me cacher. Je suis à deux avions du pays, je cherche encore une place de parking, je tourne, je tourne, je n’ai pas renoncé. Et m’avoue chaque jour qui passe de plus en plus passionné par cette question sans réponse posée par Pascal Sevran dans l’un de ses carnets, au siècle dernier (c’est-à-dire hier) : « Quelle heure est-il dans ma vie ? »
Pour recevoir gratuitement les nouveaux articles publiés
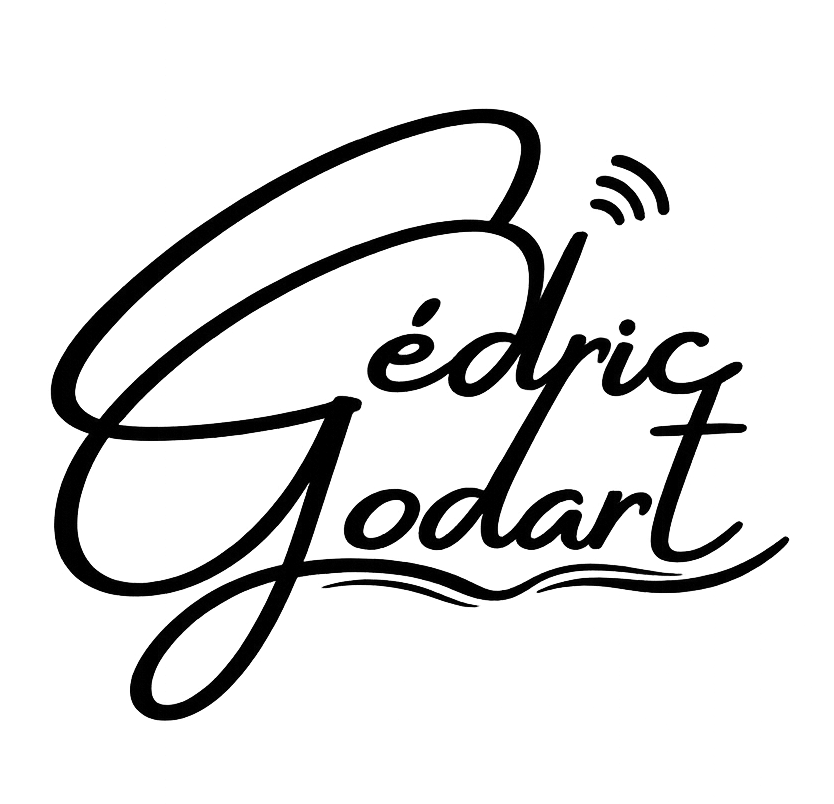

Member discussion